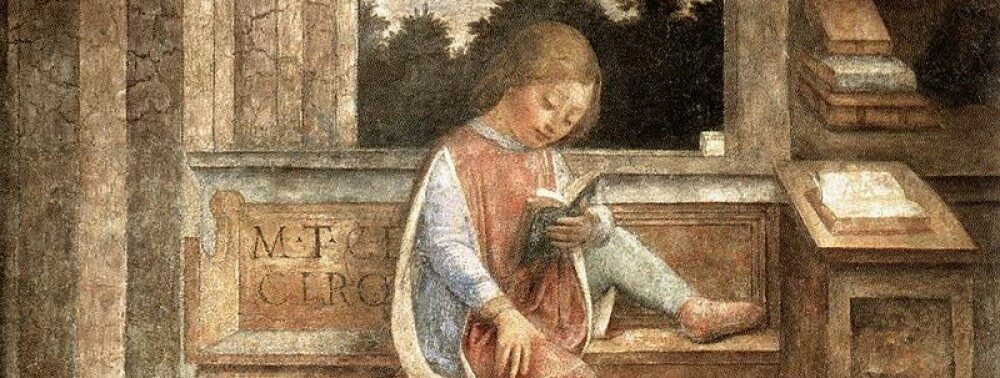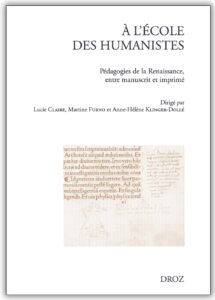Nous avons le plaisir d’annoncer la parution d’À l’école des humanistes. Pédagogies de la Renaissance, entre manuscrit et imprimé, un ouvrage sous la direction scientifique de Lucie Claire, Martine Furno, Anne-Hélène Klinger-Dollé, chez Droz dans la collection en accès libre « Eruditio ». En voici la présentation :
Archives par mot-clé : commentaire
L’Antiquité selon Guillaume Budé – À l’école d’un humaniste érudit
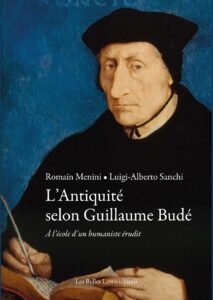 Nous signalons la parution d’un ouvrage de Romain Menini et Luigi-Alberto Sanchi, L’Antiquité selon Guillaume Budé. À l’école d’un humaniste érudit, le 15 janvier 2025, aux Belles Lettres dans la collection « Essais ».
Nous signalons la parution d’un ouvrage de Romain Menini et Luigi-Alberto Sanchi, L’Antiquité selon Guillaume Budé. À l’école d’un humaniste érudit, le 15 janvier 2025, aux Belles Lettres dans la collection « Essais ».
Parmi les géants de son temps, Guillaume Budé tient une place à part. Il est assurément le plus singulier des lettrés français de la première Renaissance. Contemporain d’Érasme et de Thomas More, il posa comme nul autre avant lui – mais aussi après lui, peut-être – la question des humanités en France, ainsi que les bases d’une réflexion nationale en la matière. Parallèlement à son rôle dans la politique culturelle du royaume, ses ouvrages montraient la voie encyclopédique d’études qui n’entendaient laisser de côté aucun domaine de la connaissance antiquaire : philologie du Digeste, patristique, lexicologie du grec ancien, érudition numismatique, histoire économique. Autant de domaines qui, de nos jours, n’apparaissent plus guère dans un cursus de lettres classiques, voire d’histoire ancienne. Or les recherches savantes auxquelles Budé s’adonna tout au long de sa vie ne sauraient être comprises, dans leur portée et dans leur signification, qu’en étant replacées dans le contexte qui fut le leur. Sans cet effort historique – lequel était déjà au fondement de la démarche même de Budé face à l’Antiquité –, nous risquons de nous heurter à un monde incompréhensible. Ainsi sonnait déjà la leçon des écrivains de la « Renaissance » : c’est en tentant de comprendre de l’intérieur les civilisations révolues, dans toute la diversité de leurs préoccupations – et quitte à mesurer ce qui nous en sépare –, que nous en pourrons tirer les enseignements les plus utiles à notre temps.
TABLE DES MATIERES
Avant-propos
Qui était Guillaume Budé ?
Budé, géant héroïque des lettres françaises
Quelques éléments de biographie
Saisir Protée : contours de l’encyclopédie budéenne
Au filtre de la manière budéenne
Une érudition de grand style
L’invention d’un nouveau genre d’écriture
Inventer l’« encyclopédie » : cercle et périphrases
Saisir Protée : inattingible, l’Antiquité ?
Quel « discours de la méthode » ?
Une périodisation d’humaniste
Le premier millénaire avant notre ère : convergence des histoires sainte et classique
De l’Antiquité classique à la fin de la civilisation antique
Trois massifs philologiques
Annotationes in Pandectas
De Asse
Commentarii linguæ græcæ
Dans l’atelier de l’humaniste : Budé parmi ses livres
Budé correcteur de lui-même
Notes, fiches et carnets
Livres annotés
La bibliothèque de Budé
Un exemple : Démosthène manuscrit et imprimé
Les nouveautés de la librairie aldine
Livres prêtés, livres empruntés : le réseau budéen
Le philologue au travail : chemins de la recherche érudite
Droit romain, morale et anthropologie
Le droit chez les éléphants et les bêtes sauvages
L’épineuse question de l’équité
Des centumvirs à la Vulgate : Budé et la Bible
De l’entéléchie (Aristote) à la loi d’Adrastée (Platon)
Un point de départ : la doxographie du pseudo-Plutarque
Le De Asse et la ψυχή selon Aristote et Cicéron
Cicéron et Politien au pilori
Le corpus aristotélicien et ses commentateurs
Platon, inadmissible païen ou sage préchrétien ?
La loi Adrastia
Fortune, hasard, nécessité, liberté
Philosophie e(s)t Éloquence
La fabuleuse histoire du million de sesterces
En premier lieu, constater le problème et son étendue
Ensuite, échafauder la démonstration résolutive
Enfin, montrer les avantages scientifiques de la solution obtenue
Deux ouvrages pour deux publics
Défense et illustration de la langue grecque
Une constante : l’apologie pour une « langue géniale »
Suite du panégyrique… en français
Le lexique grec, corne d’abondance
L’étude du grec, rempart nécessaire contre le purisme
Dithyrambe pour Philoponie
L’ascèse et l’exégèse : Budé lecteur des Pères grecs
Les Pères cappadociens, figures tutélaires
Vie solitaire, sodalités spirituelles
Ascèse de la philologie, philologie de l’ascèse
« Denys le Grand » : le rayonnement et l’énigme
Sur la foi de l’apocryphe : le sublime du pseudo-Denys
Guillaume Budé, bâtisseur de la modernité française
Budé en son temps, Budé pour notre temps
Du « tonneau » de Diogène….
… à l’Hercule gaulois
Le Gymnase de Marseille, puis le Collège de France
Une nouvelle école française d’érudition
Un héritage aux contours extensibles
L’inventeur de la monographie savante ?
Ouverture : L’Antiquité selon Budé est-elle l’avenir des études anciennes ?
Notes
Aperçu de la bibliothèque de Guillaume Budé
Tableau chronologique des œuvres de Guillaume Budé
Bibliographie
Index nominum
Cours et séminaires 2024-2025
Jean-Yves Tilliette, Littérature latine du moyen âge. Les jeux d’une langue poétique
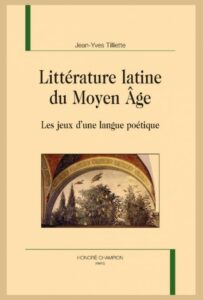 Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, le 28 mai 2024, aux éditions Honoré Champion, d’un ouvrage de Jean-Yves Tilliette, Littérature latine du Moyen Âge. Les jeux d’une langue poétique, dans la collection « Essais sur le Moyen Âge ».
Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, le 28 mai 2024, aux éditions Honoré Champion, d’un ouvrage de Jean-Yves Tilliette, Littérature latine du Moyen Âge. Les jeux d’une langue poétique, dans la collection « Essais sur le Moyen Âge ».
Lien vers le site de Champion : https://www.honorechampion.com/fr/editions-honore-champion/13043-book-08536090-9782745360908.html
En voici la présentation :
Les seize études recueillies dans ce volume entreprennent d’explorer certaines des contrées qui composent un continent aujourd’hui oublié de notre ancienne littérature : la poésie latine du Moyen Âge. Elles entendent le faire en adoptant le point de vue de la critique littéraire tout autant que celui de l’analyse philologique et historique. Car la langue savante ne s’est pas alors cantonnée aux usages de la pratique documentaire et de la philosophie scolastique. Elle est aussi créatrice généreuse de formes et de récits. Elle a même d’autant plus vocation à s’incarner sous les espèces de la littérature qu’elle n’est plus langue naturelle. Dès lors, elle peut cultiver en toute liberté les effets du « second degré » et entretenir un dialogue fécond et souvent plein d’esprit, tantôt drôle tantôt sérieux, avec l’œuvre des grands anciens, Virgile ou Ovide, et les témoins les plus brillants des jeunes littératures vernaculaires, poèmes des troubadours ou Roman de Renart. Voilà les jeux de paroles et de sens que l’on s’efforce d’illustrer ici d’exemples variés.
Jean-Yves Tilliette, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles- Lettres, a été professeur de langue et de littérature latines du Moyen Âge à l’Université de Genève de 1990 à 2019. Ses recherches portent principalement sur la poésie latine du Moyen Âge central (XIe-XIIIe siècle) étudiée sous l’angle de son fonctionnement rhétorique et de l’adaptation des modèles classiques au contexte social et religieux du temps. C’est dans cet esprit qu’il a édité l’œuvre poétique complète de Baudri de Bourgueil (1998-2002), analysé la Pœtria nova de Geoffroy de Vinsauf (2000), et commenté et traduit l’Alexandréide de Gautier de Châtillon (2022).
TABLE DES MATIERES
https://www.honorechampion.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=2691
*
Jean-Yves Tilliette est aussi l’auteur d’un ouvrage paru chez Droz plus tôt cette année, dans la collection « Recherches et rencontres » : La saveur des mots. Essais sur l’art d’écrire au Moyen Âge.
Publication des actes du dernier congrès de la Semen-l
Florence Vuilleumier Laurens, L’Université, la robe et la librairie à Paris. Claude Mignault et le Syntagma de symbolis (1571-1602), Genève, Droz, « Travaux d’Humanisme et Renaissance », 2017 (Laurence Boulègue)

Florence Vuilleumier Laurens, L’Université, la robe et la librairie à Paris. Claude Mignault et le Syntagma de symbolis (1571-1602), Genève, Droz, « Travaux d’Humanisme et Renaissance », 2017, 329 p., 49 €.
Consacré au Traité des symboles de Claude Mignault, l’ouvrage de Florence Vuilleumier Laurens comble une lacune importante à la fois dans le champ des études consacrées à l’œuvre de l’auteur lui-même et dans celui consacré aux Emblèmes d’Alciat, dont le brillant commentaire de Mignault est pourtant bien connu, sans que la célèbre préface Syntagma de symbolis ait pourtant fait l’objet d’une traduction française et d’une véritable histoire. C’est chose faite désormais grâce à la première édition et traduction en langue française de ce texte, préface des éditions des Emblemata depuis 1571, mais plusieurs fois remis sur l’ouvrage et augmenté par le commentateur. Le travail sur le texte est fondé sur l’édition aboutie et définitive de 1602, mais aussi sur la consultation des quatre éditions précédentes (1571, 1573, 1577, 1581), des deux versions de 1584 (version compendiosa et version latino- française abrégée) et des modifications ou ajouts apportés par les éditons de 1577 et 1621. C’est ce minutieux travail philologique – accompagné d’une élégante traduction en regard du texte latin – qui a permis d’approfondir l’histoire du texte et de sa composition, de 1571 à 1602, étudiée dans la vaste étude introductive (p. 7-152). L’ouvrage est complété par un Index nominum très complet et diverses annexes présentant notamment les autres pièces liminaires de l’auteur.
L’étude de Florence Vuilleumier Laurens montre le lien étroit, chez Mignault, entre la théorie de l’emblème et de l’allégorie, son enseignement académique et son parcours dans les milieux de l’édition et des juristes en développant quatre aspects de la carrière de l’auteur et du développement d’un genre autour et à partir de l’emblème. La première partie est consacrée au parcours de formation de Mignault jusqu’à son entrée à l’Université qui coïncide avec la première version des commentaires et du Syntagma de symbolis. La deuxième partie étudie l’évolution de la théorie et de la pratique du commentaire humaniste de Landino, Politien, Juste Lipse, jusqu’à Pierre de la Ramée, éclairant la conception exposée dans le Syntagma de symbolis, en particulier celle de l’allégorie, précédant et préparant ainsi, dans un troisième temps, l’analyse de la préface elle-même et de ses différentes strates de composition, nœud et résultat de l’enquête philologique ici menée avec rigueur, qui éclaire la collaboration entre Mignault et Plantin de 1573 à 1581 et l’évolution de la simple préface initiale en un traité fondateur pour toute l’Europe de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle, séduite par le symbole, l’emblème, l’énigme. La quatrième partie offre une analyse des « enjeux théoriques du Syntagma » et de la création par l’auteur d’un genre réunissant les diverses formes, antiques et modernes, qui dessinent le champ du symbolique, fondé sur le modèle pythagoricien pour aboutir aux premières devises royales.
La lecture du traité de Mignault et la remarquable étude qu’en fait Florence Vuilleumier Laurens entraînent le lecteur dans un monde à la fois connu – celui du commentaire humaniste au sens large – et énigmatique – celui- là même qui fascine aussi Mignault et l’emmène à définir un nouveau champ philologique.
Laurence Boulègue (UPJV)
Cette recension a été publiée dans le Bulletin de liaison n°17 (2019) de la SEMEN-L (p. 42-43).
Colloques 2017-2018
– 20-22 septembre 2017, IRHT (Centre Félix-Grat) et École nationale des chartes, colloque « Le manuscrit franciscain retrouvé », Organisation : BnF et IRHT, avec le soutien du LabEx Hastec, du Centre de recherches historiques (EHESS-CNRS), d’APICES, de la Fondation André Vauchez (Balzan) et de la galerie Les Enluminures
– 26-28 septembre 2017, Paris, Université Paris 7, La fureur dans tous ses états, org. laure_westphal@hotmail.fr (Laboratoire CRPMS, UFR d’Etudes Psychanalytiques), annegrondeux@gmail.com (Laboratoire HTL, UMR 7597) dubreuil.marthe@orange.fr (Laboratoire CRPMS, UFR d’Etudes Psychanalytiques)
– 12-13 octobre 2017, IRHT (Centre Félix-Grat), BnF (site François-Mitterrand), colloque « Census. Recenser et identifier les manuscrits par langue et par pays », Organisation : F. Bougard, M. Cassin (IRHT), A. Postec (BnF)
-13 octobre, Florence, journée d’études Attualizzare il passato. Percorsi della cultura europea moderna fra storiografia e saperi degli antichi, org. Ida Gilda Mastrorosa, Università degli Studi di Firenze.
– 19 octobre 2017, Paris, 17h00 – 19h00, Bibliothèque de la Sorbonne – Salle de formation de la BIS, Luigi-Alberto Sanchi, « La Renaissance du grec et ses conséquences ».
– 26-27 octobre 2017, Nanterre, La réception d’Ausone dans les littératures européennes, Université Paris Nanterre, Bâtiment Max Weber, org. E. Wolff, Équipe THEMAM, UMR 7041 ArScAn, contact : ewolff@parisnanterre.fr
– 16 novembre 2017, Paris, 17h00 – 19h00, Bibliothèque de la Sorbonne – Salle de formation de la BIS, Gilles Couffignal, La Renaissance des langues.
– 17 novembre 2017, 10 h-18 h. Chartres, Médiathèque l’Apostrophe. Journée d’étude « Les rescapés du feu : l’imagerie scientifique au service des manuscrits de Chartres ». Organisation Médiathèque l’Apostrophe de Chartres, CRCC, IRHT
– 23-24 novembre, École française de Rome, colloque : « ‘Tocco di’. Chansonniers aux mains des humanistes italiens et français ». Organisation : Maria Careri (IRHT, Univ. Chieti Pescara), École française de Rome (LAMOP)
– 1er décembre 2017, Louvain, Université de Louvain-la-Neuve, Journée d’études du projet Schol’Art, 1er décembre 2017, org. A. Smeesters, A. Guiderdoni et R. Dekoninck.
– 4-5 décembre 2017, Paris, La Bible et sa réception dans les arts, Moyen-Age, Renaissance, Epoque moderne, 2e colloque MEODE, org. C. Cosme, E. Ingrand, F. Ploton, OT Venard et V. Zarini.
– 13 décembre 2017, Amiens, journée d’études mastériale Écritures et pratiques du commentaire de l’Antiquité à la Renaissance, org. L. Boulègue et L. Claire, Université de Picardie Jules Verne, Logis du Roy.
– 14 décembre 2017, Paris, 17h00 – 19h00, Bibliothèque de la Sorbonne – Salle de formation de la BIS, Michela Malpangotto, Peut-on parler d’un « Humanisme arabo-latin » ? Le cas de l’astronomie.
– 18 janvier 2018, 17h00 – 19h00, Bibliothèque de la Sorbonne – Salle de formation de la BIS, Clémence Revest, Les lieux de mémoire de l’Humanisme.
– 25-27 janvier 2018, Université de Strasbourg, Poésie, Bible et théologie de l’Antiquité tardive au Moyen Âge (IVe-XVe siècle), org. Gianfranco Agosti, Frédéric Chapot, Michele Cutino, Patricio de Navascués, François Ploton-Nicollet, Vincent Zarini.
– 1-3 février 2018, Aix-en-Provence, MMSH, salle Duby, Colloque international sur les Pratiques artistiques et littéraires des architectures et décors fictifs de l’Antiquité au XVIIIe siècle : entre fiction, illusion et réalité, org. Pedro Duarte (pedro.duarte@univ-amu.fr), Cécile Durvye (durvye@mmsh.univ-aix.fr), G. Herbert de la Portbarré-Viard (gaelle.viard@dbmail.com), Renaud Robert (renaud.robert@u-bordeaux3.fr)
– 8 février 2018, 17h00 – 19h00, Bibliothèque de la Sorbonne – Salle de formation de la BIS, Adeline Lionetto et Nahéma Khattabi, Les fêtes de Fontainebleau (1564) : musique et poésie au temps des Valois.
– 14-17 mars 2018, Würzburg, Formen der Selbstthematisierung in der vormodernen Lyrik (bis 1650), org. T. Baier (thomas.baier@uni-wuerzburg.de), B. Burrichte (brigitte.burrichte@uni-wurzburg.de), M. Erler (michael.erler@wuerzburg.de), I. Karreman (isabelle.karremann@uni-wuerzburg.de) et D. Klein (dorothea.klein@germanistik.uni-wuerburg.de).
– 22 mars 2018, 17h00 – 19h00, Bibliothèque de la Sorbonne – Salle de formation de la BIS, Gaëlle Demelemestre : Philosophie et droit chez les humanistes.
– 22-24 mars 2018, Hilton New Orleans Riverside, RSA 2018, Conference hashtag: #RenSA18
– 23-25 mars 2018, Université de Dijon, L’imperfection de l’Antiquité à la Renaissance, org. S. Laigneau-Fontaine et X. Bonnier.
– 26-28 mars 2018, 10h-17h, IRHT (Centre Augustin-Thierry, Orléans), Médiathèque d’Orléans, Journée d’étude « Mémoires musicales et notations millénaires dans les sources antiques et médiévales », Organisation : D. Delattre, J.-F. Goudesenne (IRHT) et M. Pérès (Cerimm, Moissac)
– 19 avril 2018, 17h00 – 19h00, Bibliothèque de la Sorbonne – Salle de formation de la BIS, Luisa Brunori, Banques et finances à la Renaissance.
– 3-5 mai 2018, Les Noces de Philologie et de Guillaume Budé, Paris, 3-5 mai 2017, org. C. Benevent, R. Memini et L.-A. Sanchi.
– 4 mai, 10 h-17 h, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Journée thématique « 80 ans de recherche à l’IRHT », Organisation : IRHT
– 15-16 mai 2018, Trento, Le dialogue dramatique de l’Antiquité à la Renaissance : théories et pratiques, org. Giorgio Ierano, U. Trento et Laurence Boulègue, UPJV/ EA 4284 TrAme.
– 17 mai 2018, 17h00 – 19h00, Bibliothèque de la Sorbonne – Salle de formation de la BIS, Pascale Dubus, Le retour à l’antique dans la peinture italienne de la Renaissance
– 25 mai 2018, Journée d’étude en hommage à Pierre Courcelle, org. Olga Vassilieva-Codognet et Vincent Zarini.
– 30 mai – 1er juin 2018, Université de Caen, Congrès de la SEMEN-L – « Rire et sourire dans la littérature latine, au Moyen Âge et à la Renaissance », org. B. Gauvin.
– 14, 15 et 16 juin 2018, Université de Göttingen, Colloque international et interdisciplinaire Mollesses de la Renaissance : Défaillances et assouplissement du masculin, org. Daniele Maira, contact : daniele.maira@phil.uni-goettingen.de
– 2-5 juillet 2018, CESR- Université de Tours, Les femmes illustres de l’Antiquité grecque au miroir des Modernes (XVe-XVIe siècles), org. D. Cuny, S. Ferrara et B. Pouderon.
– 29 juillet- 7 août 2018, Albacete, XVIIe Congrès de l’Association Internationale d’Etudes Néo-Latines. Site web : http://eventos.uclm.es/6255.html
Cours et séminaires 2017-2018
Pour accéder à la liste des cours et séminaires de l’année universitaire 2017-2018 dans les domaines médio- et néo-latins, veuillez cliquer sur le lien suivant : Cours et séminaires 2017-2018
Cours et séminaires 2017-2018
IIe journée des jeunes chercheurs de la SEMEN-L
La SEMEN-L organise le samedi 13 mai 2017 une deuxième journée consacrée à ses jeunes chercheurs : programme jeunes chercheurs 2017
Programme Jeunes chercheurs 2017
9h30 Accueil des participants
9h45 Ouverture de la journée
(Re)définition et renouvellement des savoirs
Présidence : Danièle James-Raoul
(Université Bordeaux Montaigne, EA 4593 CLARE)
10h00 Aude STUDER (École nationale des Chartes, EA 3624 Centre Jean Mabillon) :
« Théologie naturelle ou connaissance naturelle de Dieu ? L’invention
paradoxale d’une nouvelle discipline théologique »
10h35 Pierre-Yves CAUTY (Université Sorbonne nouvelle-Paris 3, EA 173 CERAM) :
« L’image de Dieu au miroir de l’œuvre de Grégoire de Tours »
11h10 Gaétan LEMAITRE (École nationale des Chartes, EA 3624 Centre Jean
Mabillon) : « Le De Partibus Aedium, Lexicon Utilissimum de Francesco Maria
Grapaldo (Parme, 1494) »
− Déjeuner −
Poétique des textes médio- et néo-latins
Présidence : Laurence Boulègue
(Université de Picardie Jules Verne, EA 4284 TrAme)
14h00 Nicolas CASELLATO (Université Paris-Sorbonne, EA 4081 Rome et ses
renaissances) : « Permanence et renouvellement de l’élégie latine classique
dans les Amores de Conrad Celtis (1459-1508) »
14h35 Julien MAUDOUX (Université Bordeaux Montaigne, EA 4593 CLARE) : « À
propos de quelques textes médio-latins autour de la figure de la vieille
femme »
− Pause −
Lecture des classiques à l’époque humaniste
15h30 Vincent BRUNI (Université de Picardie Jules Verne, EA 4284 TrAme) :
« Quelques aspects de la réception du livre X de l’Institutio oratoria dans le De
imitatione de Bartolomeo Ricci »
16h05 Astrid QUILLIEN (Université Sorbonne nouvelle-Paris 3, EA 174 FIRL) : « Le
commentaire de Denis Lambin à l’Art poétique d’Horace (1561-1568) : un
commentaire évolutif et « en réseau » »
Andrea Severi, Filippo Beroaldo il Vecchio un maestro per l’Europa. Da commentatore di classici a classico moderno (1481-1550), Bologne, Il Mulino, 2015. (Olivier Pédeflous)
Andrea Severi, Filippo Beroaldo il Vecchio un maestro per l’Europa. Da commentatore di classici a classico moderno (1481-1550), Bologne, Il Mulino, 2015. 416 p.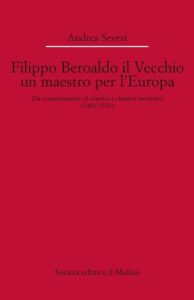
Ce volume offre une belle contribution d’étude de réception européenne, non seulement le célèbre commentaire à l’Âne d’or mais aussi la littérature morale sortie de la plume de Béroalde. Ce travail monstre le magistère de Béroalde, qui a formé à Bologne nombre d’étudiants étrangers qui ont rapporté sa science et sa méthode dans leur pays. L’ouvrage est fondé sur un recensement provisoire très précieux des manuscrits contenant des œuvres de Béroalde, le philologue, le correspondant, le panégyriste en particulier. Il s’intéresse aussi au portrait de l’humanisme italien à l’étranger qui en ressort, en particulier la transmission des spécificités de l’école bolonaise que celui-ci a contribué à créer.
Olivier Pédeflous
Cette recension a été publiée dans le Bulletin de liaison n°14 (2016) de la SEMEN-L (p. 21).