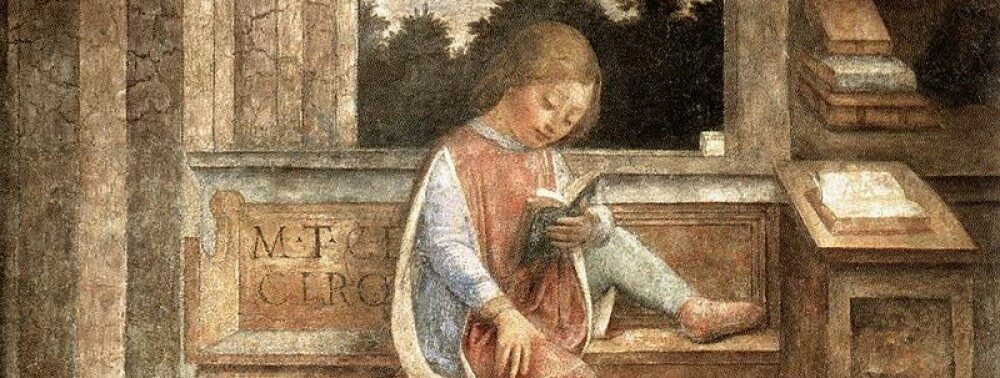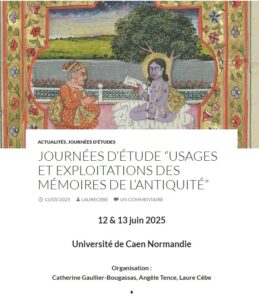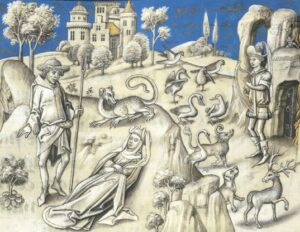Claire Absil, La représentation de la montagne chez les humanistes européens : Sources et renouveaux d’une symbolique au tournant du XVIe siècle (dir. Virginie Leroux et D. Amherdt) ; 2023-.
Chloé Audouy, Éditer, traduire et commenter les Joca monachorum (dir. Christiane Veyrard-Cosme et François Ploton-Nicollet).
Ysé Avocat, Étude des paratextes de l’édition séparée des Ad Senecæ Medeam commentarii de M. Raderus, Munich, 1631 (dir. Pascale Paré-Rey) ; 2022-.
Cassandre Azi, « Joyeux dans le ciel ». Les écrits consacrés à la mort d’Anne de Joyeuse. Édition et commentaire (dir. Virginie Leroux et Julien Goeury) ; 2024-.
Pierre-Olivier Beaulnes, Édition critique de la traduction latine de l’Oneirocriticon du pseudo-Achmet effectuée par Leo Tuscus. Étude de la traduction et de la réception d’un traité d’oniromancie byzantin du Xe s. (dir. Frédéric Giraud) ; 2024-.
Caroline Benoit, Pour une nouvelle écriture de l’histoire de l’humanité à la Renaissance : les historiens grecs et leurs traductions latines dans le De inuentoribus rerum de Polydore Virgile, 1499 (dir. Anne Raffarin).
Nicolas Brisbois, Les traductions latines des dialogues apocryphes de Platon par l’humaniste allemand Willibald Pirckheimer (dir. Anne Raffarin et James Hirstein).
Vincent Bruni, Le De imitatione (1541) de Bartolomeo Ricci : édition, traduction et commentaire du livre I. Pédagogie et humanisme au seizième siècle italien (dir. Laurence Boulègue) ; sept. 2019-.
Davide Bruno, La question féminine au tournant des XVe et XVIe siècles. L’Apologia mulierum (1529) de Pompeo Colonna (dir. L. Boulègue et I.-G. Mastrorosa) ; nov. 2023-.
Hélène Bufort, Édition, traduction et commentaire des Neapolitani poematum Libri de Pietro Gravina (dir. Hélène Casanova-Robin) ; 2023-.
Lorenzo Caprari, I Carmina di Lovato Lovati : edizione critica, traduzione e commento (dir. Silvia Fiaschi).
Francesca Carnazzi, L’Interpretatio super Suetonium di Domizio Calderini : edizione critica (titolo provvisorio) / Interpretatio super Suetonium de Domizio Calderini : édition critique (titre provisoire) (dir. Paolo Pellegrini et Laurent Baggioni).
Gabriele Cascini, Formes du comique dans les Dialogues latins de Giovanni Pontano : entre sources antiques et arts du spectacle (dir. Hélène Casanova-Robin et Giuseppe Germano) ; 2023-
Giovanna Cascone, Penser le luxe et les arts entre Italie et Espagne au XVe siècle : le laboratoire napolitain. Anthologie de textes, édition critique et traduction (dir. Florence Bistagne et Antonietta Iacono) ; 2024-
Clément Château, Mythologie et poétique du mythe dans l’œuvre poétique et musicale de Guillaume de Machaut, 1300-1377 ; (dir. Valérie Fasseur).
Violaine Chaudoreille, La réception des élégies érotiques d’Ovide au XVIe siècle (dir. Sandra Provini).
Sara Cusset, Le Charme et la Prophétie. Édition critique et commentaire du livre XIV de l’Ovide moralisé jusqu’au vers 3550 (dir. Marylène Possamaï-Pérez et Mattia Cavagna).
Fabrice Delplanque, Édition, traduction et commentaire du Livre V du De poeta d’Antonio Sebastiano Minturno, 1559 (dir. Virginie Leroux) ; 2018-.
Francesc De Luca, Uomini, processi e tradizioni culturali intorno a Girolamo Soncino : un’esperienza imprenditoriale tra Pesaro e Fano agli inizi del Rinascimento (dir. Silvia Fiaschi).
Gianluca Del Noce, Une politique de la « grandeur » : théorisation, construction et réception de modèles culturels à Naples entre le XVe et le début du XVIe siècle (1442/1532) (dir. Florence Bistagne et Guido Cappelli) ; 2024-
Rita Di Pasquale, Édition complète et commentée des poèmes latins de Pietro Bembo (dir. Luca. Marcozzi et Giuseppe Crimi).
Stéphanie Dubarry, Les figures de l’inspiration dans le De Deis gentium… historia de Lilio Gregorio Giraldi, 1548 (dir. Virginie Leroux) ; 2021-.
Petros Fokianos, Les savants grecs et les enjeux de l’hellénité dans l’Italie humaniste, du concile de Ferrare-Florence à l’expulsion des Médicis, 1434-1498 (dir Benoît Grévin).
Lucas Fonseca, Édition, traduction et commentaire du recueil Parthenopeus siue Amores de Giovanni Pontano (dir. Hélène Casanova-Robin et A. Iacono) ; 2020-.
Inès Gabillet, Les textes latins des pièces sacrées de Marc-Antoine Charpentier : édition, analyse, mise en contexte (dir. François Ploton-Nicollet).
Marie Gall, Âme, Imagination et nouveaux systèmes cosmobiologiques dans les fictions scientifiques du XVIIe siècle (dir. Violaine Giacomotto-Charra).
Léa Gariglietti, Le livre sonore des amantes sonoritatis : réception de la Seconde sophistique dans le Theatrum veterum rhetorum de Louis de Cressolles (1620) (dir. Sophie Comte, CD URCA) ; 2023-
Blandine de Germay, Former l’intériorité au XIVe siècle : l’Orationarium du célestin Pierre Poquet. Édition critique et commentaire (dir. Frédéric Giraud) ; 2020-.
Théo Gibert, Le théâtre de Pierre Corneille et la culture jésuite (dir. Virginie Leroux et O. Leplâtre) ; 2021-.
Constance Griffejoen, Circulation des savoirs de l’Antiquité dans les éditions néo-latines de Catulle au XVIIè siècle (dir. Virginie Leroux) ; 2025-.
Alessia Grillone, La traduction latine de l’Éthique à Nicomaque IV d’Aristote, par Giovanni Argyropoulos (Hélène Casanova-Robin et Ermanno Malaspina). Thèse soutenue à Turin le 14 novembre 2025.
Mia Guilot, Lectrices, traductrices, autrices, mécènes : les femmes et la littérature antique au XVIe siècle (1475-1615) (dir. Sandra Provini).
Helena Hunzue Gros, « Alienum aliquid ». L’autre au miroir d’un triumvirat humaniste : Érasme, Budé, Vives, Université Aix-Marseille (dir. Tristan Vigliano et Virginie Leroux)
Juliette Joliot, Les œuvres poétiques néolatines de Girolamo Angeriano : édition, traduction, annotation et commentaire (dir. Emilie Séris et Antonietta Iacono).
Gabriel de Labretoigne, Edition critique du traité de spiritualité de Richard de Saint-Victor, De exterminatione mali et promotione boni (dir. Dominique Poirel).
Louisa Laj, Penser la tragédie grecque au XVIe siècle : l’exemple de la réception d’Eschyle (dir. Malika Bastin).
Valérie Letercq : La traduction latine de l’Iphigénie à Aulis d’Erasme (dir. Sylvie Laigneau-Fontaine et Estelle Oudot), 2019-.
Anne Lemerre-Louerat, La poésie des Météores, de l’humanisme latin du XVe aux poètes français de la Renaissance (dir. Hélène Casanova-Robin et Anne-Pascale Pouey-Mounou), ; thèse soutenue le 8/11/2025 à la Sorbonne.
Florentin Maroye, Les traductions latines des trois comédies d’Aristophane (Les Guêpes, La paix, Lysistrata) par Florent Chrestien (1541-1596) (dir. Laurence Boulègue et Nathalie Catellani) ; sept. 2021-.
Paméla Mauffrais, Édition, traduction et commentaire de l’Isottaeus Liber (1449), recueil élégiaque en trois livres composé par Basinio de Parme (dir. Hélène Casanova-Robin) ; 2022-
Nicolas Mazel, Fortune des Héroïdes d’Ovide au Moyen Âge (XIe-XVe siècles) : domaine français, latin et italien (dir. Frédéric Giraud et M. Possamaï) ; 2021-.
Farah Mercier, Autour de Denis Petau (Dionysius Petavius S.J., 1583-1652) : étude du réseau relationnel d’un jésuite français (dir. Aline Smeesters et Hannes Cools).
Anne-Claude Mérieux, Penser l’éducation du roi dans les romans des XIIe et XIIIe siècles : Alexandre, Arthur et Josaphat (dir. Frédéric Giraud et Valérie Fasseur) ; 2021-.
Geneviève de Montalembert, Art musical sous la voûte céleste : une étude de la pensée musicale de Ficin au regard des textes antiques (dir. A. Raffarin et Jean-Baptiste Guillaumin) ; 2025-.
François Mottais, L’héritage de Stace dans la poésie latine tardive : permanences et innovations (IVe-VIe siècles après J.-C.) (contrat doctoral de l’Univ. Paris-Ouest-Nanterre ; dir. É. Wolff et François Ploton-Nicollet).
Sacha Orval, Édition, traduction et commentaire des deux premiers livres de l’Argénis de Jean Barclay (dir. Virginie Leroux) ; 2023-.
Lisa Pichon, Entre poésie et philosophie : la satire dans la pensée d’Isaac Casaubon (1559-1614) (dir. Laurence Boulègue et S. Aubert Baillot), sept. 2024-.
Hannelore Pierre, D’Ausone à Élie Vinet. La Commémoration des professeurs bordelais d’Ausone et sa réception dans les milieux humanistes bordelais de la Renaissance (dir. Violaine Giacomotto-Charra et Renaud Robert) ; soutenance prévue printemps 2026.
Jérémie Pinguet, Édition, traduction et commentaire des Nénies de Salmon Macrin (dir. Virginie Leroux et S. Laigneau-Fontaine) ; 2021-.
Giorgia Paparelli, Tra.Ma.Bo : tradizione e ricezione di Boccaccio nelle Marche fra i secc. XIV-XVI (dir. Silvia Fiaschi).
Corentin Poirier, Écrire la cuisine en latin du XIIe au XVe siècle (dir. Bruno Laurioux).
Mathilde Pommier, Admirabilia, miracula, mira exempla : rêves, présages, fantasmes dans la littérature humaniste : les Geniales Dies d’Alessandro d’Alessandri, 1522 (dir. Anne Raffarin).
Giorgia Puleio, Edizione critica del Directorium ad passagium faciendum (prima metà Trecento) (dir. Anne-Marie Turcan-Verkerk et Paolo Chiesa).
Gaëtan Ravoniarison, La pensée juridique de Claude de Seyssel (v. 1450-1520) : la tradition à l’épreuve de l’humanisme (dir. Xavier Prévost et B. d’Alteroche).
Julien de Ridder, Humanisme et révolution poétique au onzième siècle : recherches sur les carmina varia de Marbode de Rennes (dir. Baudouin van den Abeele et Cédric Giraud).
Thibault Robert, Huic Latia atque recens Slavica Musa canit. Édition, traduction et commentaire des Odes et des Épigrammes latines de Jan Kochanowski (1530-1584) (dir. Virginie Leroux et Grazyna Urban-Godziek).
Baptiste Robaglia, La pensée juridique d’Étienne Pasquier (1529-1615) (dir. Xavier Prévost et P. Cocatre-Zilgien) ; soutenance prévue le 10 avril 2026.
Céline Robert, Les Épîtres de Raoul Tortaire (XIe-XIIe siècles) : édition multimodale, traduction et commentaire (dir. Marie-Agnès Lucas-Avenel et Benoît Gauvin).
Sofia Santosuosso, Langages du pouvoir : forme et réception de la rhétorique papale dans la summa dictaminis de Thomas de Capoue (1213-1268) / Linguaggi del potere : forme e ricezione della retorica papale nella Summa dictaminis di Tommaso di Capua (1213-1268) (dir. Benoît Grévin en cotutelle EHESS-Ca’ Foscari ) ; 2023-
Ben Schoentgen, Rome triomphante (1559) : les enjeux d’une restauration (dir. Anne Raffarin).
Felix Schultze, Recherches sur les manuscrits médicaux de la bibliothèque cistercienne d’Altzelle (dir. Frédéric Giraud et C. Cardelle de Hartmann) ; 2021-.
Caroline Supply, La veine poétique néo-latine du deuil familial au tournant du XVe et du XVIe siècle en Italie. Étude de la construction du discours poétique et des représentations (dir. Aline Smeesters).
Iulia Székely-Calma, Le succès médiéval d’un pseudo-Aristote. Édition et étude de la diffusion du Liber de causis (XIIIe-XVIe siècles) (dir. D. Poirel et François Ploton-Nicollet).
Amélie Tissier : Édition, traduction commentaire du Paeddagogion de Nicolas Bourbon (dir. Sylvie Laigneau-Fontaine et Lucie Claire), 2025-.
Claire Varin d’Ainvelle, Greffe, transplantation, acclimatation : transformations du végétal dans la littérature française de la Renaissance (dir. Violaine Giacomotto-Charra).
Stéphane Vincent, Figurer l’invisible : représentations et symboliques du vent dans l’art italien de la Renaissance (textes et images) (co-direction Florence Bistagne, Avignon Université) avec Raphaele Mouren, British School at Rome), 2025-
Clément Zajac, Edition, traduction et commentaire de la Lyrica poesis praeceptionibus et exemplis illustrata de Jacob Masen, 1654 (dir. François Ploton-Nicollet).