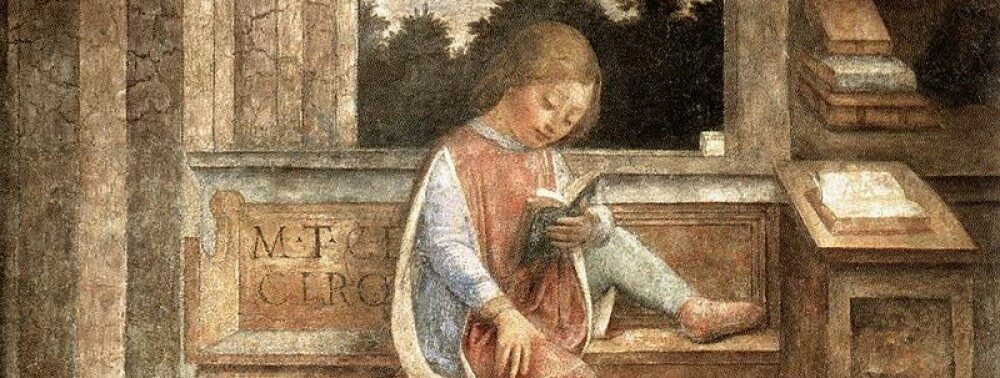- De persequutione aduersus Locarnenses (Tadeo Dunno)
Cette liste des parutions récentes concernant la littérature en médiolatin et néo-latin a été réalisée par Caroline Heid, Alice Lamy et Florence Vuilleumier Laurens pour le bulletin n°23 de la Société paru en novembre 2025.
PUBLICATIONS RÉCENTES
Textes :
– Agricola Rodolphe, L’Invention dialectique, éd., trad. P. Collé, coll. « L’Univers rhétorique », Paris, Classiques Garnier, 2025, 720 p. : [De inuentione dialectica libri tres].
– Angelomo di Luxeuil, Opusculum in Canticis Canticorum . Edizione critica a cura di Luigi G. G. Ricci , coll. « Millenio Medievale » 130, Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2025, CXC-173 p.
– Ps.-Anselmo di Laon, Glose in Apocalipsin. Edizione critica e commento a cura di Federico De Dominicis, coll. « OPA » 10, Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2025, XII-633 p.
– Balbi Girolamo : voir Cortesi Alessandro.
– Baudier Dominique, The Correspondence of Dominicus Baudius, éd. P. Botley, coll. « Travaux d’Humanisme et Renaissance », Genève, Droz, 2025, 2 vol. 1504 p.
– Bayer Gottlieb Siegfried, La localisation de la Scythie au temps d’Hérodote (1726). Les travaux d’un humaniste prussien et leur impact sur les maîtres de la Russie, éd., trad. comm. S. Peyrefiche, coll. « Chartæ Neolatinæ », Neuville-sur-Saône, Chemins de Tr@verse, 2025, 100 p. : [De Scythiæ situ].
– Bernard de Clairvaux, Les degrés de l’humilité, intr. et notes Pierre-André Burton, trad. Jeannine Abbiateci, coll. Cédric Giraud, Christian Heck et Laurence Mellerin, Paris, Les Éditions du Cerf, 2025 (Sources chrétiennes, 647), 440 p.
– Biondo Flavio, Rome triomphante/ Roma triumphans, V. Livres IX et X, préf. A. Rouveret, intr. A. Raffarin ; livre IX : éd. E. Falaschi, A. Raffarin, trad. notes E. Falaschi, V. Naas ; livre X : éd., trad., notes A. Raffarin, coll. « Les Classiques de l’Humanisme », Paris, Les Belles Lettres, 2025, LXIV-362 p.
– Bracciolini Poggio, Guarino da Verona, Del Monte Pietro, Bracciolini Poggio, On Leaders and Tyrants, éds., trad. H. Schadee, K. Sidwell, D. Rundle, coll. « I Tatti Renaissance Library », Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2024, 624 p.
– Breve compendium in duo prima capita tertii De anima Aristotelis. A Critical Edition with Introduction and Indices, ed. S. Demo, P. Gregorić, coll. « Studia Artistarum », 52, Turnhout, Brepols, 2024, 134 p.
– Bruno Giordano, Les ombres des idées, coll. « De Pétrarque à Descartes », Paris, Vrin, 2024, 192 p. : [De umbris idearum].
– Bruno Giordano, Œuvres complètes, II. Le Souper des Cendres/ La Cena de le Ceneri, nvle éd. rev. corr. Z. Sorrenti, trad. Y. Hersant, notes G. Aquilecchia, M.Á. Granada, coll. « Giordano Bruno », Paris, Les Belles Lettres, 2025, ccl-442 p.
– Comenius Iohannes Amos, Orbis Sensualium Pictus/ Image du monde sensible, trad., prés., comm. L.X. Polastron, Paris, Les Belles Lettres, 2025, xxiv-324 p.
– Conradus de Strazburg, Iohannes de Sacrobosco, Petrus Cunestabulus, Petrus de Bernia, Radulphus de Longo Campo, Willelmus computista, auctores ignoti, Opera de computo a tempore post Gerlandum usque ad Iohannem de Sacrobosco, ed. Alfred Lohr, « CCCM » 272A, Turnhout, Brepols, 2025, CXL + 788 p.
– Cortesi Alessandro, Laudes bellicæ, Balbi Girolamo, Épigrammes, intr., éd., trad. F. Mottais dans Éloges de Matthias Corvin, roi de Hongrie, en guerrier, coll. « Chartæ neolatinæ », Neuville-sur-Saône, Chemins de tr@verse, 2024, 152 p.
– Del Monte Pietro (Monti Pietro) : voir Bracciolini Poggio.
– Du Pui Meinard Simon, Oratio de prosperis atque aduersis, quæ Academiæ Lugduno-Batauæ anno elapso contigerunt, Boston, Brill, 2024, 25 p. : e-book (PDF) [Lugduni Batauorum, 1820].
– Érasme de Rotterdam Désiré, « De recta Latini Græcique sermonis pronuntiatione dialogus »-Dialogue sur la prononciation correcte du latin et du grec, trad. J. Chomarat †, éds. C. Bénévent, G. Clerico, B. Colombat, C. Nativel, coll. « Travaux d’Humanisme et Renaissance », Genève, Droz, 2025, 488 p.
– Érasme Désiré, Les Colloques. Dialogues de la vie courante, propres non seulement à polir le langage de la jeunesse mais à édifier ses mœurs, éd. crit. Amsterdam (1972) émendé, prés., trad. O. Sers, rév. D. Sonnier, coll. « Miroir des Humanistes », Paris, Les Belles Lettres, 2025, 1372 p.
– Érasme, Desiré, Collected Works of Erasmus, 79. Controversies, éds. R. Begley, C. Begley, D. Sheerin, trad. D. Sheerin, R. Begley, Toronto, University of Toronto Press, 2025, 432 p.
– Fabricius Franciscus, Oratio inauguralis de Christo unico et perpetuo Ecclesiæ fundamento, habita in auditorio maiori, Boston, Brill, 2024, 52 p. : e-book (PDF) [Lugduni Batauorum, 1706].
– Flaminio Marcantonio, Navagero Andrea, Latin Pastoral Poetry, éd., trad. A.M. Wilson, coll. « I Tatti Renaissance Library », Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2025, 528 p.
– Gallico Giovanni, Ritus canendi uetustissimus et nouus, éd. crit. G. Pirani, coll. « La Tradizione musicale. Studi e testi », Firenze, Sismel-Il Galluzzo, 2025, XLII-548 p.
– Gerardus Magnus, Opera omnia IV, 1 : Epistolae, ed. Rijcklof Hofman, Marinus van den Berg. « CCCM » 318, Turnhout, Brepols, 2025, CII + 402 p.
– Gerardus Magnus, Opera omnia IV, 2 : Subsidia ad Epistolae, ed. Rijcklof Hofman, Marinus van den Berg. « CCCM » 318, Turnhout, Brepols, 2025, 388 p.
– Grégoire de Tours, Les Miracles de saint Julien de Brioude, ef. Bruno Krusch, trad. comm. Luce Pietri, Paris, Les Éditions du Cerf, 2025 (« Sources chrétiennes » 656), 190 p.
– Guarino da Verona : voir Bracciolini Poggio.
– Heymericus de Campo, Tractatus de formis intentionalibus, ed. Giovanni Bagnasco, « CCCM » 292D, Turnhout, Brepols, 2025, Lviii + 200 p.
– Histoire et hagiographie au XIIe siècle. La production de la collégiale de Saint- Martin de Tours, ed. trad. Jean-Hervé Foulon, Paris, Les Belles Lettres, 2025 (« Classiques de l’Histoire du Moyen Âge » 60), 448 p.
– Iacobus de Altavilla, Lectura in libros Sententiarum II. Questiones 7-17, ed. Monica Brinzei, Chris Schabel, « CCCM » 312A, Turnhout, Brepols, 2025, XXIX + 500 p.
– Iacopo da Varazze, Sermones de sanctis. Volumen breve. Volumen diffusum. De sancto Petro Martyre. de translatione beati Dominici, de sancto Dominico, de sancto Francisco. Edizione critica a cura di Giovanni Paolo Maggioni, coll. « Millenio Medievale » 131, Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2025, XVIII-409 p.
– Lettres fictives d’un humaniste. L’enseignement du grec à la Renaissance, dir. E. Dickey, éd. crit., trad., comm. M. Bernardot, M. de Toledo, E. Dickey, A. Grouard de Tocqueville, P. Carmela la Barbera, E. Lefèvre, V. Lévy, C. Mambrioni, L.-J. Tissot, coll. « Fragments », Paris, Les Belles Lettres, 2025, CXLII+218 p.
– Luscinius Othmar : voir Nachtgall.
– Macquelyn Michaël Iacob (Macquelijn), Oratio de medicinæ practicæ doctore fideli artis historico, Leiden-Boston, Brill, 2024, 24 p. : e-book (PDF) [Lugduni Batauorum, 1824].
– Muratori L.A., Carteggi con Hackmann… Lazarelli, éds. M. Lieber, D. Gianaroli, V. Cuomo, J. Klingebeil, R.M. Christoph, coll. « Edizione nazionale del carteggio di L.A. Muratori. Centro di studi muratoriani », Firenze, Olschki, 2025, 600 p.
– Muratori L.A., Panegirico per Luigi XIV (1693-1694), préf. F. Marri, éd. C. Viola, texte latin, trad. ital. G. Burzacchini, coll. « Biblioteca dell’Edizione nazionale del carteggio di L.A. Muratori. Centro di studi muratoriani », Firenze, Olschki, 2025, vi-96 p.
– Nachtgall Othmar (Luscinius), « Grunnius Sophista »-Grogneur le Sophiste, éd., trad. M. Dietrich, coll. « Travaux d’Humanisme et Renaissance », Genève, Droz, 2025, 408 p.
– Naudé Gabriel, Œuvres complètes, X A. « Pentas Quæstionum iatro-philologicarum » / Cinq questions iatrophilologiques, préf. L. Bianchi, éd. A.L. Schino, postf. O. Trabucco, coll. « Textes de philosophie », Paris, Classiques Garnier, 2024, 557 p.
– Navagero Andrea : voir Flaminio Marcantonio.
– Panormita Antonio, Alfonsi regis dicta aut facta memoratu digna, éd. F. Delle Donne, Firenze, Sismel-Il Galluzzo, 2024, lix-409 p.
– Paolo Diacono, Carmina. Edizione critica a cura di Adriano Russo, coll. « Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia », Firenze, Sismel-Il Galluzzo, 2025, XII-834 p.
– Papia, Elementarium. Littera L. Edizione critica a cura di Francesca Artemisio, coll. « Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia », Firenze, Sismel-Il Galluzzo, 2024, X-237 p.
– Petrarca Francesco, Itinerarium ad Sepulcrum Domini nostri Yesu Cristi, éd. G. Cascio, coll. « Petrarca del centenario », Firenze, Le Lettere, 2024, 288 p.
– Petrarca Francesco, Orazioni politiche, éd. A. Piacentini, coll. « Petrarca del centenario », Firenze, Le Lettere, 2025, 190 p.
– Petrarca Francesco, Penitential Psalms and Prayers, éd., trad. D.S. Yocum, coll. « William and Katherine Devers Series in Dante and Medieval Italian Literature », Notre Dame (IN), University of Notre Dame Press, 2024, 160 p.
– Pico della Mirandola Giovanni, 900 Conclusions, éd., trad. B.P. Copenhaver, coll. « I Tatti Renaissance Library », Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2025, 688 p.
– Polenton Sicco, « Scriptorum illustrium Latinæ linguæ libri ». Livio, Plinio, Seneca e altri prosatori, un’antologia della prima storia della letteratura latina antica, éd. R. Modonutti, G. D’Alessandro, Firenze, Sismel-Il Galluzzo, 2024, cxiii-198 p.
– Profetto Giacomo, Sulla natura dei diversi tipi di vino. « De diuersorum uini generum natura », intr., trad., notes L. Coco, coll. « Particelle elementari », Firenze, Olschki, 2024, xx-112 p.
– Radulfus Ardens, Speculum universale, Libri XI-XIV, ed. Claudia Heimann, Stephan Ernst, « CCCM 241B », Turnhout, Brepols, 2025, LXII + 920 p.
– Radulphi Britonis Quaestiones super librum Divisionum Boethii. Radulphi Britonis Opera Philosophica, vol. 1, ed. S. Ebbesen., C. Marmo, coll. « Studia Artistarum », 50, Turnhout, Brepols, 2024, 118 p.
– Raymond Lulle, Œuvres Complètes, Tome VI, , coll. « Doctrines médiévales vi », Paris-Metz, Messkhy Publications, 2025, 433 p.
– Reinwardt Caspar Georg Carl, Oratio de augmentis, quæ historiæ naturali, ex Indiæ inuestigatione accesserunt, Boston, Brill, 2024, 26 p. : e-book (PDF) [Lugduni Batauorum, 1827].
– Robortello d’Udine Francesco, Explications au livre d’Aristote sur l’Art poétique/ « In librum Aristotelis de arte poetica explicationes », intr., éd., trad. S. Poujade-Baltazard., coll. « Les Classiques de l’Humanisme », Paris, Les Belles Lettres, 2025, cxlii-1406 p.
– Sambucus Iohannes [Zsámboky János], Epistulæ, éds. G. Almási, L. Šubarić, coll. « Europa Humanistica. Répertoires et inventaires », Turnhout, Brepols, 2024, 511 p.
– Simler Josias, « Vallesiae Descriptio » / Description du Valais, intr., trad., notes A. Andenmatten, K. Bovier, coll. « Sapheneia », Basel, Schwabe Verlag, 2025, 367 p.
– Stephanus de Borbone, Tractatus de diversis materiis predicabilibus. Quarta pars. De dono fortitudinis (tituli 1-7a), ed. Jacques Berlioz, Luc Ferrier, « CCCM 124C », Turnhout, Brepols, 2025, LII + 714 p.
– Wedsted Christian, The latin poems, éd. A. Palmore coll. « Bloomsbury neo-latin series. Early modern texts and anthologies », London, Bloomsbury, 2025, 288 p.
En ligne :
– Bèze Théodore de, Cato Censorius Christianus (1599), intr., éd., trad. K. Bovier, dans Humanistica Helvetica, v. 12.02.2025, 12 p. : https://humanistica-helvetica.unifr.ch/fr/works/197
– Depraz Jean, Franc Chrétien (l’Ancien), Poème sur la légion thébaine et Discours sur saint Maurice (1618), dans Humanistica Helvetica, intr., éd., trad. A. Andenmatten, v. 19.03.2025, 4 p. : https://humanistica-helvetica.unifr.ch/fr/works/200
– Duno Taddeo, La Persécution contre les Locarnais/ De persequutione aduersus Locarnenses (1602), intr., éd., trad. D. Amherdt, dans Humanistica Helvetica, v. 18.02.2025, 11 fol. : https://humanistica-helvetica.unifr.ch/fr/works/199
– Egi Raphaël, Les Rosicruciens existent vraiment/ Assertio Fraternitatis Roseæ Crucis (1614), intr., éd., trad. K. Bovier, dans Humanistica Helvetica, v. 07.02.2025, 6 p. : https://humanistica-helvetica.unifr.ch/fr/works/196
– Franc Chrétien (l’Ancien) : voir Depraz Jean.
– Viret Pierre, Centon sur la messe/ Centonis de theatrica Missæ saltatione, ex uariis ueterum poetarum scriptis consarcinati libri quatuor (1553), intr., éd., trad. K. Bovier, dans Humanistica Helvetica, v. 29.04.2025, 27 p. : https://humanistica-helvetica.unifr.ch/fr/works/201
À paraître :
– Ficino Marsilio, Commentary on Plotinus, vol. 1. Ennead I, éd., trad. S. Gersh, coll. « I Tatti Renaissance Library », Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 512 p. : à paraître en 2026.
– Gama José Basílio da, Brazilian Goldmines, éds. L. Ribeiro Leite, D. Fernandes Nascimento, coll. « Bloomsbury Neo-Latin Series », London, Bloomsbury, 272 p. [Brasilienses Aurifodinæ] : à paraître en 2026.
– « Grant fu la jeste, bien en doit on parler ». Mélanges en l’honneur de Bernard Ribémont, éds. Ph. Haugeard, N. Lombart, F. Michaud-Fréjaville et J. Véronèse, Paris, Classiques Garnier, 636 p. : à paraître en 2026.
– Polenton Sicco, Lives of the Famous Latin Authors. A Selection, éds. T.E. Franklinos, R. Modonutti, coll. « Bloomsbury Neo-Latin Series », London, Bloomsbury, 240 p. : à paraître en 2026.
Études :
– À l’école des Humanistes. Pédagogies de la Renaissance, entre manuscrit et imprimé, dir. L. Claire, M. Furno, A.-H. Klinger-Dollé, coll. « Eruditio », Genève, Droz, 2025, 598 p. : e-book (PDF).
– A Sceptical Jew. Richard H. Popkin’s Private Republic of Letters, dir. J.D. Popkin, A. Salah, G. Veltri, coll. « Maimonides Library for Philosophy and Religion », Leiden-Boston, Brill, 2025, 522 p. G. Bartolucci, G. Veltri, « The Marrano Conspiracy: On Richard Popkin, Jewish Scepticism, and an Unknown Text on Zindīḳ by Pietro Pomponazzi », 56–69.
– Alla maniera: Technical Art History and the Meaning of Style in 15th to 17th Century Painting. Papers presented at the Twenty-Second Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting held online, 28-30 March 2022, dir. A. Dubois, coll. « Underdrawing and Technology in Painting. Symposia », Louvain, Peeters, 2024, VI-339 p.
– Alonge T., Dieu dramaturge. Bible et tragédie de Buchanan à Racine, coll. « Travaux du Grand Siècle », Genève, Droz, 2024, 424 p.
– Amalou T., La Sorbonne entre en guerre de religion. Autorité universitaire, censure et pouvoir royal en France (v. 1551-v. 1589), coll. « Travaux d’Humanisme et Renaissance », Genève, Droz, 2024, 592 p.
– Angelini R., Orbis Normannicus. Repertorio degli autori latini in Normandia (secoli X-XIII), coll. « Quaderni di CALMA » 5, Firenze, Sismel-Il Galluzzo, 2025, LXXXV-496 p.
– Aux marges de l’encyclopédie : circulation des savoirs de l’Antiquité à l’Âge de l’Humanisme, dir. T. Miguet, A. Raffarin, coll. « Colloques, congrès et conférences-le Moyen Âge », Paris, Honoré Champion, 2025, 286 p.
– Baroque Latinity. Studies in the Neo-Latin Literature of the European Baroque, éds. J. Glomski, G. Manuwald, A. Taylor, coll. « Bloomsbury Neo-Latin Series », London, Bloomsbury, 2025, 224 p. [Anthologie].
– Bercea-Bocskai N., Le Corpus signé Hélisenne de Crenne. Entre Virgile et la Grande Rhétorique, coll. « Bibliothèque de la Renaissance », Paris, Classiques Garnier, 2024, 495 p.
– Bibliographie Internationale de l’Humanisme et de la Renaissance, 56 (2024), lxxvi-949 p. [Travaux parus jusqu’en 2023].
– Bibliothèque idéale de la Consolation de l’Antiquité au xviie siècle, dir. C. Martin-Ulrich, M. Gally, S. Luciani, coll. « Bibliothèque idéale », Paris, Les Belles Lettres, 2025, 592 p.
– Bonaventura autore spirituale. A cura di M. Guida e D. Solvi, « La Mistica critiana tra Oriente e Occidente » 37, Firenze, Sismel-Il Galluzzo, 2025, IX – 312 p.
– Campillo Bo Á. J., Akribeia. Certainty and Ontology of Mathematics in Alessandro Piccolomini’s « De certitudine mathematicarum », coll. « History of Metaphysics: Ancient, Medieval, Modern », Leiden-Boston, Brill, 2025, 319 p.
– Carrió Cataldi L. A., Temps, sciences et empire. Cosmographie et navigation dans les monarchies ibériques au xvie siècle, coll. « Techne », Turnhout, Brepols, 2025, 276 p.
– Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, vol. XXII. Région Bourgogne, éd. D. Coq, coll. « Histoire et civilisation du livre », Genève, Droz, 2025, 712 p.
– Charrier S., Recherches sur l’œuvre latine en prose de Robert Gaguin (1433-1501), coll. « Bibliothèque de la Renaissance », Paris, Classiques Garnier, 2024, 576 p.
– Cholcman T., Festival Emblems. A Paradox along the Triumphal Route, coll. « Imago Figurata. The Emblem and Related Forms », Turnhout, Brepols, 2025, vi-234 p.
– [La] Comédie humaniste en France, dir. E. Buron, J. Goeury, coll. « Cahiers V.L. Saulnier », Paris, PUPS, 2025, 324 p.
– Communicating the Passion. The Socio-Religious Function of an Emotional Narrative (1250-1530), dir. P. Delcorno, H. Johnson, coll. « Early European Research », Turnhout, Brepols, 2025, 400 p.
– Contending Representations III. Questioning Republicanism in Early Modern Genoa, dir. E. Zucchi, A. Metlica, coll. « Dunamis », Turnhout, Brepols, 2024 : M. Schnettger, « Camera et ciuitas nostra imperialis. The Republic of Genoa in the Imperial Perspective », 34-45.
– Coroleu A., Latin Political Propaganda in the War of the Spanish Succession and Its Aftermath, 1700-1740, coll. « Bloomsbury Neo-Latin Series », London, Bloomsbury, 2025, 232 p.
– Cossu A., Zambardi E. (éd.), Uses and Reuses of Medieval Manuscript Books. Southern Italy. Latin Manuscripts, coll. « Bibliologia », 71, Turnhout, Brepols, 2025, 300 p.
– [Il] Dante di Petrarca, Atti del Convegno internazionale di Arezzo, 4-6 novembre 2021), dir. M. Capriotti, N. Tonelli, A. Valenti, coll. « Studi sul Petrarca », Padova, Antenore, 2024, 330 p.
– Dolbeau F., Le plaisir de découvrir. Études de philologie latine (IVe-XIIe siècles) Textes édités par B. Valtorta, « coll. MediEvi » 44, Firenze, Sismel-Il Galluzzo, 2025, XII – 712 p.
– Donner à voir l’Antiquité. Genèse, fonctions et circulation des représentations figurées de l’Antique (xvie-xixe siècle), dir. A.-H. Klinger-Dollé, V. Krings, F. Pugnière, coll. « Scripta Receptoria », Bordeaux, Ausonius, 2025, 386 p.
– Dunkelgrün T., The Multiplicity of Scripture. The Making of the Antwerp Polyglot Bible, coll. « Studies and Texts », Turnhout, Brepols, 2025, xxvi-554 p.
– Early Music Pedagogy Then and Now. From the Classical Antiquity to the Renaissance, dir. M. Mazzetti, L. Ticli, coll. « Musica Incarnata », Turnhout, Brepols, 2025, xxxii-448 p.
– [La] Fabrique de l’espace religieux en Europe centrale (xe–xvie siècle), dir. M.M. de Cevins, O. Marin, coll. « Rencontres », Paris, Classiques Garnier, 2025, 448 p.
– Figurer la nature. Les métamorphoses de l’allégorie (xiiie-xviie siècles), dir. R. Dekoninck, A. Guiderdoni, B. Van den Abeele, coll. « Textes, Études, Congrès », Turnhout, Brepols, 2024, 275 p.
– Filosofia e medicina in Italia fra medioevo e prima età moderna, dir. L. Bianchi, L. Campi, coll. « Studia Artistarum », Turnhout, Brepols, 2025, 272 p.
– Fournier Y., « Tactus », notation mensuraliste et contrepoint à la Renaissance. Pour un contexte théorique et une épistémologie pratique, coll. « Historiæ Musicæ Cultores », Firenze, Olschki, 2025, xiv-586 p.
– Gendry C., Achille et Patrocle, un mythe du couple masculin, coll. « Perspectives comparatistes-Genres, sexes, textes », Paris, Classiques Garnier, 2025, 741 p.
– Geografie del Petrarca, dir. G. Belloni, M. Pastore Stocchi, F. Piovan, coll. « Studi sul Petrarca », Padova, Antenore, 2024, 204 p.
– Hengstermann C., Critique of the Teutonic Philosophy and Other Writings against Jacob Böhme. Text, Translation and Introduction, coll. « The latin Works of Henry More », Louvain, Peeters, 2024, XII-335 p.
– Hiernard J., De Moravie en Italie. Voyage universitaire et « Grand Tour » européen (1596-1602). L’éphéméride du baron Waldstein, coll. « Scripta Receptoria », Bordeaux, Ausonius, 2025, 560 p.
– Hommes et femmes du livre à Rouen au xvie siècle. « Liber amicorum Petri Aquilonis », dir. T. Claerr, É. Lalou, A.-B. Levollant, coll. « Études Renaissantes », Turnhout, Brepols, 2025, 280 p.
– [El] humanismo latino en el Studium de Salamanca : Nebrija y Europa, dir. M. Adelaida Andrés Sanz, C. Codoñer, D. Paniagua, coll. « Estudios clásicos », Madrid, Guillermo Escolar, 2024, 256 p.
– « In spinis collige rosas ». Mélanges offerts à Jean-François Maillard par ses collègues et amis, dir. J.-M. Flamand, F. Fery-Hue, M.-E. Boutroue, coll. « Europa Humanistica. La France des humanistes », Turnhout, Brepols, 2025, 420 p.
– Introduction à l’Humanisme juridique. Auteurs, œuvres, idées, formes, destinées, dir. X. Prévost, L.-A. Sanchi, coll. « Cahiers d’Humanisme et Renaissance », Genève, Droz, 2025, 600 p.
– Jaspers M., Should we Declare War on the Turks ? Petrus Nannius’ « Declamatio de bello Turcis Inferendo » (Leuven, Rutger Rescius, 1536), coll. « Spicilegium Sacrum Lovaniense », Leuven, Peteers, 2024, XII-155 p.
– Johann Buxtorf, Impresario of Hebrew and Jewish Books, éd. A. Grafton, J. Weinberg, coll. « Studies and Texts » Turnhout, Brepols, 2025, xii-276 p.
– Kim H.-A., Music, Rhetoric and Christian Hebraism in Early Modern Europe. Reuchlin’s Reconstruction of the « Modulata Recitatio », Amsterdam, Amsterdam University Press, 2025, 474 p.
– Kristinsdottir G., La Guerre civile romaine dans la tragédie française (1550-1650). Poétique et politique, coll. « Études et essais sur la Renaissance-République des muses », Paris, Classiques Garnier, 2024, 610 p.
– L’amour au Moyen Âge. Est-il un, est-il pluriel ?, dir. D Poirel, Turnhout, Brepols, 2025, 244 p.
– Leibniz e l’Italia. Atti delle giornate di studio (Roma, Villa Mirafiori, 28-29 nov. 2019), dir. R. Palaia, coll. « Lessico intellettuale europeo », Firenze, Olschki, 2024, xvi-362 p.
– Letteratura latina medievale (secoli VI-XV). Un manuale. A cura di C. Leonardi. Nuova edizione con un aggiornamento bibliografico a cura di F. Santi, « Galluzzo Paperbacks »7, Firenze, Sismel-Il Galluzzo, 2025, XIV – 592 p.
– [La] « Malebouche ». Les paroles blessantes, du Moyen Âge à l’Âge des Lumières, dir. F. Mariani Zini et N. Vienne-Guerrin, coll. « Le Savoir de Mantice », Paris, Honoré Champion, 2025 : F. Meroi, « Dal biasimo alla menzogna. Linguaggio e natura umana nel Momus di Leon Battista Alberti », 125-142.
– Malhomme F., Musique et juste milieu à l’âge humaniste et classique, coll. « Bibliothèque de la Renaissance », Paris, Classiques Garnier, 2024, 510 p.
– Mandonnet P., Dante the Theologian, éds. G. Corbett, P. Kelly, coll. « Studia Traditionis Theologiæ », Turnhout, Brepols, 2025, 237 p.
– Markevičiūtė R., Das lateinische Lehrgedicht der Frühen Neuzeit im Angesicht der Moderne. Eine Theorie hybrider Dichtung, Berlin-Boston, De Gruyter, 2025, 355 p.
– Martigny C., Devenir Jocaste. Naissances et renaissances du personnage, de l’Antiquité à nos jours, coll. « Perspectives comparatistes-Classique/Moderne », Paris, Classiques Garnier, 2025, 846 p.
– McCullough G.J., Jacob Boehme and the Spiritual Roots of Psychotherapy. Dreams, Ecstasy, and Wisdom, coll. « Studies in Theology and Religion », Leiden-Boston, Brill, 2025, xviii-308 p.
– McDonald W.C., « Trithemius and King Arthur. Angels, Troy, the Franks, and Emperor Maximilian I of Habsburg », Cahiers de recherches médiévales et humanistes-Journal of Medieval and Humanistic Studies, 48, 2 (2024), 471-493.
– Mémoires des passés antiques. Une élaboration continue (xive-xixe siècles), dir. C. Gaullier-Bougassas, coll. « Recherches sur les Réceptions de l’Antiquité », Turnhout, Brepols, 2025, 332 p.
– Menini R., Sanchi L.-A., L’Antiquité selon Guillaume Budé. À l’école d’un humaniste érudit, coll. « Les Belles Lettres/ essais », Paris, Les Belles Lettres, 2025, 256 p.
– [Les] Métamorphoses d’Apulée à travers les lieux et les âges. Réceptions, réécritures, héritages, dir. J. Dalbera, coll. « Rencontres », Paris, Classiques Garnier, 2024, 314 p.
– Moderni e antichi. Quaderni del Centro di studi sul Classicismo, sér. II, VI (2024), 296 p. : [Lorenzo Valla].
– [The] Multilingual Dynamics of Medieval Literature in Western Europe, c. 1200-c. 1600, dir. B. Besamusca, L. Demets, J. Hugen, coll. « Medieval Texts and Cultures of Northern Europe », Turnhout, Brepols, 2025, 250 p.
– [The] Munich Court Chapel at 500. Tradition, Devotion, Representation, dir. S. Gasch, coll. « Epitome musical », Turnhout, Brepols, 2025, 719 p.
– Music and Liturgy for the Benedicamus Domino c. 800-1650, dir. C.A. Bradley, coll. « Épitomé musical », Turnhout, Brepols, 2024, 398 p.
– Nassichuk J., The Comparative Poetics of Homeric Literary Imitation from Antiquity to Renaissance France. Aphrodite’s Charm, coll. « Medieval and Renaissance Authors and Texts », Leiden-Boston, Brill, 2025, xiv-518 p.
– Nouvelles traductions et réceptions indirectes de la Grèce ancienne, t. 1. Histoires des héros grecs et troyens (textes et images, 1300-1560) ; t. 2. Traductions de textes grecs et translatio studii, éd. C. Gaullier-Bougassas, coll. « Recherches sur les Réceptions de l’Antiquité », Turnhout, Brepols, 324 p. et 310 p.
– Panzica A., De la Lune à la Terre. Les débats sur le premier livre des Météorologiques d’Aristote au Moyen Âge latin (la tradition parisienne, xiiie-xve siècles), coll. « Studia Artistarum », 53, Turnhout, Brepols, 2025, 859 p.
– Passalacqua M., Frammenti di filologia nei secoli IX e X, coll. « Traditio et renovatio » 12, Firenze, Sismel-Il Galluzzo, 2025, XI- 135 p.
– Pelizzari S., « Nelli occhi della filosofia ». La logica nell’opera di Dante Alighieri, coll. « Rencontres de philosophie médiévale », Turnhout, Brepols, 2025, xiv-502 p.
– Peña S.F., L’Humanisme français face à la violence religieuse (1470-1604). De la querelle à l’agonie, préf. D. Crouzet, coll. « Bibliothèque d’histoire de la Renaissance », Paris, Classiques Garnier, 2025, 386 p.
– Pociūtė D.,The Reformation in Lithuania. Origins and Developments up to 1570, coll. « Brill Research Perspectives in Humanities and Social Sciences » et « Brill Research Perspectives in Early Modern Cultures of the Younger Europe », Leiden-Boston, Brill, 2024, x-116 p.
– « Polyhistor Europaeus ». Études sur l’âge classique offertes à Chantal Grell, dir. M. da Vinha, B. El Gammal, M. Forycki, M. Zuili, coll. « De Diversis Artibus », Turnhout, Brepols, 2025, 2 vol., 1312 p.
– Power, Vulnerability, and Sexual Violence in Medieval Literature, ed. J Bonsall and H Piercy, coll. « Gender and Sexuality in the Global Middle Ages 01 », Turnhout, Brepols, 2025, 344 p.
– Pre-modern Mathematical Thought. The Latin Discussion (13th-16th Centuries), dir. C.V. Crialesi, coll. « Investigating Medieval Philosophy », Leiden-Boston, Brill, 2025, ca 334 p.
– Prévost X., Jacques Cujas (1522-1590) jurisconsulte humaniste, 2e éd. rev. corr., coll. « Titre courant », Genève, Droz, 2025, 616 p.
– [The] Prince and the « Condottiero » in Italian Humanism and Renaissance Literature, History, Political Theory and Art, dir. M. Celati, M. Pavlova, coll. « Court Cultures of the Middle Ages and Renaissance », Oxford-Berlin-Bruxelles-Chennai-Lausanne-New York, Peter Lang, 2025, xiv-528 p.
– Quantin J.-L., The Patristic Text in the Confessional Age (16th-17th Centuries). Erudition, Theology, Censorship, coll. « Receptio Patristica », Leiden-Boston, Brill, 2025, xviii-658 p.
– Radical Thinking in the Middle Ages : Acts of the XVth International Congress of the SIEPM, Paris, 22-26 August 2022, dir. M. Brinzei, I. Caiazzo, C. Grellard, A. Robert, Turnhout, Brepols, 2025, 1177 p.
– Ratcliff M.J., Le tournant linguistique du xviiie siècle. Études d’histoire de la langue scientifique, coll. « Bibliothèque des Lumières », Genève, Droz, 2024, 496 p.
– [The] Renaissance Papacy 1400-1600, dir. N.H. Minnich, coll. « The Renaissance Society of America », Leiden-Boston, Brill, 2025, xvi-414 p.
– Renaissance Scholasticisms. Fighting Back, dir. A. Edelheit, coll. « Studies in Medieval and Reformation Traditions », Leiden-Boston, Brill, 2025, viii-346 p.
– Renaissances 1. Construction et circulation d’une catégorie historiographique (xixe-xxie siècle), dir. V. Ferrer, J.-L. Fournel, C. Lucken, coll. « Histoire des Idées et Critique Littéraire », Genève, Droz, 2024, 512 p.
– Renaissances 2. Pré-histoire de la catégorie : les mots en contexte (xiie-xviiie siècles), dir. M. de La Gorce, V. Ferrer, J.-L. Fournel, coll. « Histoire des Idées et Critique Littéraire », Genève, Droz, 2025, 560 p.
– « Révérence de l’antiquaille ». Les diverses formes de transmission du patrimoine textuel antique à la Renaissance, dir. N. Le Cadet, coll. « Rencontres », Paris, Classiques Garnier, 2025, 268 p.
– Revisiting Revenge Tragedy. New Perspectives, dir. A. Hansen, M. Prandoni, C. van der Haven, coll. « Drama and Theatre in Early Modern Europe », Leiden-Boston, Brill, 2025, 274 p.
– Rossetti F, Il commento a Persio dell’umanista Giovanni Britannico. Dalla tipografia bresciana del Quattrocento all’editoria europea del Cinquecento, coll. « Studia Humanitatis Rhenana », Turnhout, Brepols, 2025, 324 p.
– Sacrifice and Sacred Violence. History, Comparisons, and the Early Modern World, dir. C. Facchini, G. Imbruglia, V. Lavenia, S. Pavone, coll. « Studies on Philosophy, Intellectual History, Arts, Sciences », Turnhout, Brepols, 2025, 472 p. : F. Quatrini, F. Sierhuis, « Hugo Grotius’s Christology. The Sacrifice of Christ across his Religious and Political Works », 181-200 ; R. Yelle, « Where Did Sacrifice Go ? The Case of Thomas Hobbes », 201-220 ; P.-A. Fabre, « Sacrifice, Sanctity, and Martyrdom », 245-262 ; F. Motta, « Self-sacrifice in the Ordinary Duty. Early Modern Martyrial Culture and Hagiographical Rhetoric in Mathias Tanner’s Societas Iesu apostolorum imitatrix (1694) », 263-298 ; O. Christin, « Why Committing Self-sacrifice ? Martyrdom and Civic Heroism in Strasbourg (1529-30) », 421-438.
– Sant’agata, M., Boccaccio. A Biography, trad. E. Eisenach, Chicago-London, University of Chicago Press, 2025, 457 p. : [Boccaccio. Fragilità di un genio, 2019].
– Schildgen B.D., Boccaccio Defends Literature, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2024, 310 p. : [Genealogie deorum gentilium].
– Schlichter F., Mythology, Chronology, Idolatry. Pagan Antiquity and the Biblical Text in the Scholarly World of Guillaume Bonjour (1670-1714), coll. « Brill’s Studies in Intellectual History », Leiden-Boston, Brill, 2024, xviii-402 p.
– [Les] Styles de la différence. Mélanges en l’honneur de Jean Lecointe, dir. C. Gutbub, A.-P. Pouey-Mounou, S. Duval, coll. « Rencontres », Paris, Classiques Garnier, 2025, 563 p. : O. Pédeflous, « François Dubois et Ausone », 13-21 ; P. Selosse, « ’Au très brillant et très savant homme, professeur de bonnes lettres…’. L’épître dédicatoire du Catalogus plantarum (1542) de Conrad Gesner », 93-117 ; J. Céard, « L’hymnologie chrétienne et les Hymnes Ecclésiastiques de Guy Le Fèvre de La Boderie », 401-413 ; N. Dauvois., « Morata recte fabula (Ars poetica 319-320). Éthique, rhétorique et poétique à la Renaissance », 453-469.
– Suites d’Homère de l’Antiquité à la Renaissance, dir. D. Cuny, Arnaud Perrot, coll. « Recherches sur les Réceptions de l’Antiquité », Turnhout, Brepols, 2025, 371 p.
– Théâtre et Éthique en Europe sous l’Ancien Régime, dir. S. Berrégard, F. D’Antonio, coll. « Rencontres », Paris, Classiques Garnier, 2025 : J.-M. Civardi, « Autour de l’oratio morata (Heinsius, La Mesnardière, Vossius) », 209-225.
– Veltri G : voir Bartolucci G.
– William of Ware on the Sentences. Teaching Philosophy and Theology in the 13th Century between Thomas Aquinas and Duns Scotus, ed. E Dezza and A Petagine, coll. « Studia Sententiarum 8 », Turnhout, Brepols, 2025, 618 p.
– Zaino E., Raison et âme des bêtes chez Spinoza, coll. « Les Anciens et les Modernes-Études de philosophie », Paris, Classiques Garnier, 2024, 382 p.
– Zappulla M., L’Imitation d’autrui et l’Invention de soi. Le concept d’« ingenium » chez Spinoza, coll. « Les Anciens et les Modernes-Études de philosophie », Paris, Classiques Garnier, 2025, 390 p.
À paraître :
– Agbamu S., Petrarch’s « Africa » and Its Afterlives. Race, Nation, and Empire, coll. « Bloomsbury Neo-Latin Series », London, Bloomsbury, 2026, 224 p. : à paraître en 2026.
– Cleophilus’ « De coetu poetarum » and Iustus Lipsius’ « Somnium ». Dreaming of the Literary Tradition, éds. G. Manuwald, C. Scheidegger Laemmle, coll. « Bloomsbury Neo-Latin Series », London, Bloomsbury, 288 p. : à paraître en 2026.
– Laurens P., Dis-moi comment tu traduits les poètes, coll. « Les Belles Lettres/ essais », Paris, Les Belles Lettres, 269 p. : à paraître en 2026.
– Rabouin D., Mathématiques et philosophie chez Leibniz. Au fil de l’analyse des notions et des vérités, coll. « Mathesis », Paris, Vrin, 400 p. : à paraître oct. 2025.
Revues :
– Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, LXXXVI, 2-3 (2024) : M. Engammare, « Calvin et les livres apocryphes à l’épreuve de Judith. Lefèvre 1530/ Olivétan 1535/ Calvin 1546 » ; A. de Rosa, « Appunti su Giovanni Marquale libraio e un’ipotesi sul volgarizzamento dell’Emblematum liber di Alciato (1549) ».
– Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, LXXXVI, 1 (2025) : M. Danzi, « Leon Battista Alberti e il mestiere delle lettere. Su una nuova edizione e sull’interpretazione del De commodis litterarum atque incommodis » ; L. Calvié, « Henri Estienne en Italie (1552-1555) – I » ; D. Guernelli, « Secundum morem ordinis et consuetudinem uallis umbrose. Un Breviario vallombrosano miniato da Mariano del Buono ».
– Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, LXXXVI, 2 (2025) : L.-A. Sanchi, « Salomon et la ‘petite étincelle’ : Guillaume Budé lecteur de la Sagesse » ; L. Calvié, « Henri Estienne en Italie (1552-1555) – II ».
– Centaurus, 66, 1-2 (2024) : J. Gniewomir, « A Student Notebook from 16th-Century Padua. On How Method Mediated Between Medical Theory and Practice », 93-130 [Giovanni Battista da Monte].
– Emblematica. Essays in Word and Image, 7 (2023) : In memoriam P.M. Daly, 344 p. : [paru en 2025].
– Euphrosyne, 51 (2023) : A. Martínez Rodríguez, « La Coronica de Pulgar, ¿ única fuente de las Decades de Nebrija ? El reinado de Enrique IV y el conflicto con el infante Alfonso », 285-298 ; A. Lombana Sánchez, « ¿ A quién dedicó Janus Pannonius su Ep. 413 ? », 391-503 ; D. Paniagua, « El proemio de la versión manuscrita de la repetitio septima de Nebrija del códice Bolonia, Biblioteca del Real Colegio de España, ms. 132. Edición y estudio », 405-419.
– Giornale storico della letteratura italiana, CCII, 677 (2025) : A. Tissoni Benvenuti, « Nota sulla fortuna delle tragedie di Seneca nel primo Quattrocento », 76-89.
– Humanistica Lovaniensia, 73 (2024) : « In honorem Rhodæ Schnur VXorI NVrI res neoLatInas nVtrIentI horum commentariorum editores natalem gratulantur singularem », ca 650 p.
– Journal of Early Modern Christianity, 12, 1 (2025) : M. Wulf, « The Apocalypsis Nova. Narrating Prophecy and Reform Theology on the Eve of the Reformation », 63-180.
– Neulateinisches Jahrbuch/ Journal of Neo-Latin Language and Literature, 26 (2024-2025), 471 p.
– Nuncius, 40, 1 (1025) : « The Constitution of the Scientific Observation Site (15th-18th Century) : Ideal, Real, and Institutional Sites », dir. D. Deias, ca 317 p.
– Nuncius, 40, 2 (2025) : F. Geaman, « The Theatro del Cielo et della Terra. Prophecy and Plagiarism in the Venetian Monastery », 349-375.
– Réforme, Humanisme, Renaissance, 98 (2024) : Demelemestre G., « Pacte social, contrat politique et pacte religieux dans la philosophie politique d’Althusius », 175-200.
– Réforme, Humanisme, Renaissance, 99 (2024) : « Cahier Louis Meigret », dir. C. Pagani-Naudet, 256 p.
– Res Publica Litterarum, 3e ser., XLVI (2024) : A. Piacentini, « Le annotazioni filologiche di Boccaccio : lo scioglimento e la funzione delle C’ », 70-121 ; F. Monticini, « Ad eloquencie lecturam exercendam publice : il soggiorno a Napoli di Costantino Lascaris », 122-139.
– Revue d’Histoire de l’Église de France, III, 266 (2025) : A. Fagnot, « Le voyage à Rome de Charles-Maurice Le Tellier (1667-1668). Une étape dans sa carrière ecclésiastique », 5-28.
– Seizième Siècle, 24 (2024) : O. Goldman, « Collecter la nature depuis Lyon au xvie siècle : les illustrations, observations et spécimens naturalistes du médecin Jacques Daléchamps (1513-1588) », 103-122.
– Studia Islamica, 119, 2 (2024) : G. Paganini, « Prophet, Legislator or Impostor ? Mahomet and Islam in the Colloquium heptaplomeres », 341-373.
– Studies in Medieval and Renaissance Sources, ser. 4, 1 (2025) : D. Brazzale, « Re-Reading the Florentine Literary Dissent of the Fifteenth Century : The Medici Government and the Imaginary of Exile », 163-192.
Revue en ligne : 2 nouveaux numéros de la revue Camenae : (https://www.saprat.fr/instrumenta/revues/revue-en-ligne-camenae/instrumenta-revues-revue-en-ligne-camenae-camenae-n33-mai-2025/):
« Sciences et savoir en Aquitaine à l’époque de Montaigne » (n°33, mai 2025) sous la direction d’Anne Bouscharain, Violaine Giacomotto-Charra et Sabine Rommevaux-Tani.
(Camenae n°34 – octobre 2025 – Saprat)
« Latin du Moyen Âge, latin de l’époque moderne et enseignement. Actes du VIIe congrès de la SEMEN-L » (n°34, octobre 2025), sous la direction de Lucie Claire, François Ploton-Nicollet, Anne-Hélène Klinger-Dollé et Alice Lamy.