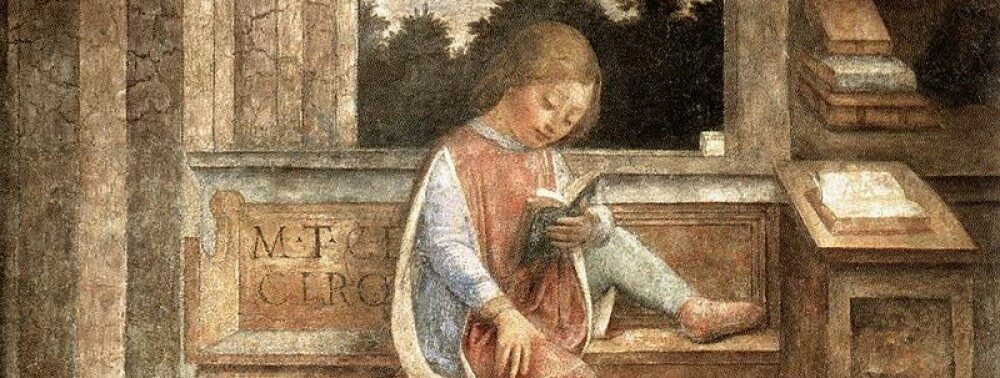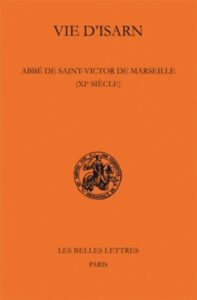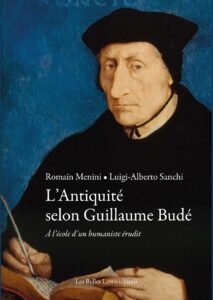 Nous signalons la parution d’un ouvrage de Romain Menini et Luigi-Alberto Sanchi, L’Antiquité selon Guillaume Budé. À l’école d’un humaniste érudit, le 15 janvier 2025, aux Belles Lettres dans la collection « Essais ».
Nous signalons la parution d’un ouvrage de Romain Menini et Luigi-Alberto Sanchi, L’Antiquité selon Guillaume Budé. À l’école d’un humaniste érudit, le 15 janvier 2025, aux Belles Lettres dans la collection « Essais ».
Parmi les géants de son temps, Guillaume Budé tient une place à part. Il est assurément le plus singulier des lettrés français de la première Renaissance. Contemporain d’Érasme et de Thomas More, il posa comme nul autre avant lui – mais aussi après lui, peut-être – la question des humanités en France, ainsi que les bases d’une réflexion nationale en la matière. Parallèlement à son rôle dans la politique culturelle du royaume, ses ouvrages montraient la voie encyclopédique d’études qui n’entendaient laisser de côté aucun domaine de la connaissance antiquaire : philologie du Digeste, patristique, lexicologie du grec ancien, érudition numismatique, histoire économique. Autant de domaines qui, de nos jours, n’apparaissent plus guère dans un cursus de lettres classiques, voire d’histoire ancienne. Or les recherches savantes auxquelles Budé s’adonna tout au long de sa vie ne sauraient être comprises, dans leur portée et dans leur signification, qu’en étant replacées dans le contexte qui fut le leur. Sans cet effort historique – lequel était déjà au fondement de la démarche même de Budé face à l’Antiquité –, nous risquons de nous heurter à un monde incompréhensible. Ainsi sonnait déjà la leçon des écrivains de la « Renaissance » : c’est en tentant de comprendre de l’intérieur les civilisations révolues, dans toute la diversité de leurs préoccupations – et quitte à mesurer ce qui nous en sépare –, que nous en pourrons tirer les enseignements les plus utiles à notre temps.
TABLE DES MATIERES
Avant-propos
Qui était Guillaume Budé ?
Budé, géant héroïque des lettres françaises
Quelques éléments de biographie
Saisir Protée : contours de l’encyclopédie budéenne
Au filtre de la manière budéenne
Une érudition de grand style
L’invention d’un nouveau genre d’écriture
Inventer l’« encyclopédie » : cercle et périphrases
Saisir Protée : inattingible, l’Antiquité ?
Quel « discours de la méthode » ?
Une périodisation d’humaniste
Le premier millénaire avant notre ère : convergence des histoires sainte et classique
De l’Antiquité classique à la fin de la civilisation antique
Trois massifs philologiques
Annotationes in Pandectas
De Asse
Commentarii linguæ græcæ
Dans l’atelier de l’humaniste : Budé parmi ses livres
Budé correcteur de lui-même
Notes, fiches et carnets
Livres annotés
La bibliothèque de Budé
Un exemple : Démosthène manuscrit et imprimé
Les nouveautés de la librairie aldine
Livres prêtés, livres empruntés : le réseau budéen
Le philologue au travail : chemins de la recherche érudite
Droit romain, morale et anthropologie
Le droit chez les éléphants et les bêtes sauvages
L’épineuse question de l’équité
Des centumvirs à la Vulgate : Budé et la Bible
De l’entéléchie (Aristote) à la loi d’Adrastée (Platon)
Un point de départ : la doxographie du pseudo-Plutarque
Le De Asse et la ψυχή selon Aristote et Cicéron
Cicéron et Politien au pilori
Le corpus aristotélicien et ses commentateurs
Platon, inadmissible païen ou sage préchrétien ?
La loi Adrastia
Fortune, hasard, nécessité, liberté
Philosophie e(s)t Éloquence
La fabuleuse histoire du million de sesterces
En premier lieu, constater le problème et son étendue
Ensuite, échafauder la démonstration résolutive
Enfin, montrer les avantages scientifiques de la solution obtenue
Deux ouvrages pour deux publics
Défense et illustration de la langue grecque
Une constante : l’apologie pour une « langue géniale »
Suite du panégyrique… en français
Le lexique grec, corne d’abondance
L’étude du grec, rempart nécessaire contre le purisme
Dithyrambe pour Philoponie
L’ascèse et l’exégèse : Budé lecteur des Pères grecs
Les Pères cappadociens, figures tutélaires
Vie solitaire, sodalités spirituelles
Ascèse de la philologie, philologie de l’ascèse
« Denys le Grand » : le rayonnement et l’énigme
Sur la foi de l’apocryphe : le sublime du pseudo-Denys
Guillaume Budé, bâtisseur de la modernité française
Budé en son temps, Budé pour notre temps
Du « tonneau » de Diogène….
… à l’Hercule gaulois
Le Gymnase de Marseille, puis le Collège de France
Une nouvelle école française d’érudition
Un héritage aux contours extensibles
L’inventeur de la monographie savante ?
Ouverture : L’Antiquité selon Budé est-elle l’avenir des études anciennes ?
Notes
Aperçu de la bibliothèque de Guillaume Budé
Tableau chronologique des œuvres de Guillaume Budé
Bibliographie
Index nominum